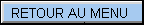|
Dictionnaire universel françois et latin, vulgairement appellé Dictionnaire de Trévoux |
| Auteure scientifique : | Isabelle Turcan : Professeur des Universités à la Faculté des Lettres de l'université de Nancy2 (UMR ATILF) |
|---|---|
| Ingénierie d'étude : | Viviane Berthelier (UMR ATILF) |
| Développement informatique : | Jean-Yves Kerveillant (UMR ATILF) |
|
LE DICTIONNAIRE DE TRÉVOUX (1704-1771), TÉMOIN DES DIVERSITÉS DE LA LANGUE ET DE LA CULTURE FRANÇAISES DANS L’EUROPE DES LUMIÈRES Texte résumé de la conférence donnée par Isabelle TURCAN le 18 octobre 2003 à Trévoux en la salle du Parlement de Dombes (remanié pour publication dans l'ouvrage collectif Quand le Dictionnaire de Trévoux rayonne sur l'Europe des Lumières, coordination scientifique Isabelle Turcan, L'Harmattan, Paris, collection "Patrimoine écrit en Europe", 2009, pp. 153-160). Résumé :La série des éditions du Dictionnaire de Trévoux (1704-1771) s’est imposée dès la première moitié du XVIIIe siècle dans l’Europe des Lumières comme le dictionnaire de référence le plus ouvert à la richesse de la langue française, à la variété des parlers, des croyances et des cultures, à la diversité du monde. Véritablement entré dans l’histoire de la langue française, ce dictionnaire a pu rivaliser avec la série institutionnelle du Dictionnaire de l’Académie française et d’autres grands dictionnaires de référence, reconnaissance dont témoignent nombre de références savantes dans les travaux scientifiques des XVIIIe et XIXe siècles. La réflexion qui nous occupe désormais concerne la place et le rôle du Dictionnaire de Trévoux (1704-1771) dans l’histoire de la langue française et de ses dictionnaires au sein de l’Europe des Lumières : il importe de montrer combien, tout au long du XVIIIe siècle, le Dictionnaire de Trévoux a été un témoin hélas souvent méconnu des diversités de la langue française, dans toutes ses composantes linguistiques et socioculturelles, et par conséquent un témoin des richesses d’une culture française, non pas restreinte à celle de la cour du Roi, à l’univers fermé d’un microcosme parisien, à la rigueur élargi au parler de la région d’Ile de France, mais ouverte au royaume dans son ensemble et au-delà de ses frontières. Nous retiendrons donc ici deux perspectives dans la continuité de l’analyse présentée lors de la précédente conférence du Parlement, où l’identité du Dictionnaire de Trévoux a été définie par rapport à l’ensemble de la série des éditions constituant, au regard de l’histoire, l’entité Dictionnaire de Trévoux : il importe désormais de montrer en quoi les différentes éditions du Dictionnaire de Trévoux ont offert une représentation précieuse des différentes composantes linguistiques et socioculturelles de la langue française aux XVIIe et XVIIIe siècles, en particulier dans un contexte de rivalités éditoriales et idéologiques marquées par une intense production de dictionnaires, pour tenter de déterminer en vertu de quels critères on peut considérer cette série comme un ensemble lexicographique particulièrement représentatif de la vie de la langue et de la culture françaises au siècle des Lumières. Envisager la diversité des formes de la langue française au XVIIIe siècle, c’est, tout comme pour les XVIe et XVIIe siècles, reconnaître, dans les dictionnaires et textes critiques grammaticaux, la pluralité des usages linguistiques réels et les principes de leur représentation, pour autant qu’on puisse les étudier à la lumière des documents dont nous disposons, face à la quête d’une norme demandée par un pouvoir soucieux d’uniformisation linguistique, soutenue par des libraires conscients de cette nécessité pour diffuser au mieux leurs ouvrages, préoccupation alimentée par des grammairiens friands de discussions sur l’usage. Mais quel usage ? Un usage, le bel Usage, ou des usages linguistiques ? Poser la question, c’est la résoudre pour partie, car une tentative d’énumération des usages linguistiques vivants à la fin du XVIIe siècle et au cours du XVIIIe siècle ne saurait constituer une liste absolument fermée, mais, bien au contraire, une liste largement ouverte avec une partie des usages auxquels les rédacteurs de notre Dictionnaire de Trévoux se sont entre autres intéressés. En priorité, la langue du Roi et de sa cour, la langue de l’écrit, celle des « meilleurs écrivains » dont les Académiciens se considéraient comme les principaux représentants, ce qui justifiait d’ailleurs leur refus de produire en leur propre dictionnaire des citations de ces meilleurs auteurs, simple refus de l’autocitation : on peut considérer que cette composante linguistique correspond, pour le XVIIe siècle, à la strate du Dictionnaire Universel de Furetière (1690) constitutive de la première édition du Dictionnaire de Trévoux (1704), strate maintenue dans les éditions ultérieures mais progressivement associée aux enrichissements empruntés, dès la deuxième édition de 1721, aux dictionnaires de la fin du XVIIe siècle tels ceux de Pierre Richelet, Gilles Ménage, l’Académie française et Thomas Corneille ; dans le domaine des lettres, on doit faire une part à la langue dite « du Palais », langue du domaine juridique dont on sait qu’elle fut largement représentée dans la première édition du Dictionnaire de l’Académie française (1694), ainsi que la langue des grammairiens — au sens large de « gens de lettres », entendons, langue des Belles Lettres —, mais assortie de considérations techniques, proprement grammaticales et historiques, avec la composante de l’étymologie : elle est omniprésente dans le Dictionnaire de Trévoux, là encore du fait conjoint de la strate Furetière et du soin pris par les rédacteurs à partir de l’édition de 1721 de reprendre les étymologies proposées par Du Cange et par Ménage, quitte à les critiquer, les compléter au fil de la série des éditions, par exemple en prenant en compte les remaniements des rééditions des sources premières du XVIIe siècle et des nouvelles productions bibliographiques. À cet égard, on prendra en considération tous les articles consacrés à l’onomastique, la science des noms propres, qu’il s’agisse des anthroponymes ou des toponymes entrés en masse à partir de 17211. À l’opposé, la langue du peuple de Paris, « le petit peuple de Paris » lit-on chez Gilles Ménage, la langue des travailleurs des Halles et celle des différents corps de métiers, des nombreuses activités de l’artisanat, la langue de toutes les communautés fermées sur un plan sociolinguistique, univers linguistique dont l’étude des sources, extrêmement diversifiées, écrites et orales, est particulièrement délicate. En effet, si l’on retient par exemple les façons de parler des matelots normands ou bretons embarqués sur un même navire pour des voyages au long cours, dont les témoignages proviennent de dictionnaires spécialisés dans le vocabulaire de la marine au XVIIe siècle, ouvrages qui furent à l’origine des textes sources du Dictionnaire de Trévoux, on constate le soin des rédacteurs du Trévoux, dès la deuxième édition de 1721, de se reporter aux sources premières, par exemple les dictionnaires de Fournier, Guillet, Desroches, sans se contenter des témoignages parcellaires produits par Antoine Furetière ou Thomas Corneille dans leurs travaux de compilation ; à partir de l’édition de 1743 (Paris), les rédacteurs du Dictionnaire de Trévoux tiennent plus particulièrement compte des sources produites depuis le début du XVIIIe siècle, animés du souci de rendre compte de l’évolution des usages et, si nécessaire, des techniques qui y sont associées, en accordant toujours plus d’intérêt à cette composante de la langue française qui a souvent échappé à l’enregistrement de l’écrit. Cependant, on ne saurait considérer la spécificité du Dictionnaire de Trévoux sans prendre en compte le principe d’évolution ou, inversement, de stagnation du discours depuis Furetière. L’exemple du verbe chommer, proposé sous forme de tableau, nous paraît à cet égard révélateur :
Excepté l’ajout de la traduction latine, les rédacteurs du Trévoux ont conservé le discours de Furetière sur l’usage breton faisant autorité pour contester l’étymologie de Ménage, mais sans le réactualiser ni le préciser, ce qui pourrait induire en erreur un lecteur non averti ; comment retrouver la source précise de cet usage sans référence nommée sans remonter aux sources de Furetière lui-même ? Mais surtout, on soulignera que l’appréciation métalinguistique concernant « le beau style », loin d’être imputable aux contributions trévoltiennes émane de l’apport de Basnage (1701). De même on se méfiera des marques d’actualisation du discours telles que encore, à présent, qui peuvent remonter à la strate Furetière, sans forcément avoir conservé la même actualité quelques décennies plus tard, ce qui peut fausser une partie du témoignage lexicographique, comme on le constate pour le nom de la monnaie valant trois deniers, le liard, dont Furetière précisait à la fin du XVIIe siècle : « Elle a cours encore dans le Lyonnois & dans le Dauphiné », phrase qu’on retrouve textuellement dans la série du Dictionnaire de Trévoux jusque dans l’édition de 1752 ! On aura compris aussi qu’on ne peut négliger la part importante des parlers des Provinces du royaume ou parlers régionaux où l’on retrouve parfois des distinctions selon les milieux sociaux et professionnels concernés ; vaste question que celle de l’étude de faits qui, relevant pour une grande part, sinon essentielle, de l’oralité, n’ont intéressé, hélas, que peu d’observateurs de la langue, peu de lexicographes et dont nous n’avons de ce fait que peu de témoignages, pour ne pas dire que des traces parfois, sans compter toutes les difficultés d’appréciation qu’en offre l’étude : ainsi, dans la continuité des remarques présentes dans le Thresor de la langue françoyse tant ancienne que moderne de Jean Nicot (1606) et dans les premiers ouvrages de Gilles Ménage (Les Origines de la langue françoyse,1650 puis les Observations sur la Langue Françoise, 1672 et 1675-76 et le Dictionnaire étymologique ou Origines de la langue françoise (1694)), les rédacteurs du Dictionnaire de Trévoux, conscients de l’importance de cette composante linguistique à laquelle s’est intéressé aussi le grammairien officiel de l’Académie française, Favre de Vaugelas dans ses Remarques sur la Langue françoise (1647), ont enrichi la strate du Dictionnaire Universel de Furetière, notamment en tenant compte des témoignages directs recueillis dans les provinces du royaume. C’est ainsi que sont bien représentés les parlers franco-provençaux, avec notamment les parlers du Dauphiné, du Lyonnais, de la Dombes, mais aussi des autres régions du royaume de France, y compris ceux des contrées frontalières, telles la Dombes et la Lorraine. Nous n’en mentionnerons que deux exemples, pour renvoyer à d’autres travaux concernant la Lorraine, région déjà présente pour son parler et sa culture dans les dictionnaires de la fin du XVIIe siècle, mais dont la matière a été considérablement enrichie dès la deuxième édition de 1721 du Dictionnaire de Trévoux2 : - la désignation d’une variété d’arbre, l’ambre, déjà présent dans le Dictionnaire Universel de Furetière pour cette acception particulière, mais sans aucune référence au parler de la région lyonnaise, précision apportée par les rédacteurs du Dictionnaire de Trévoux à partir de 1721 : Espéce de Saule appellé Salix amerina. Ce mot n’est guère usité que dans le Lyonnois. - le terme technique harpin qui est le lieu d’introduction d’une désignation propre à la navigation fluviale et dont une désignation d’usage est présentée comme régionale, harpis, HARPIN, est proprement le croc dont se servent les bateliers pour accrocher leurs bateaux à d’autres, ou aux piles des ponts, quand ils remontent, ou pour les pousser dans les lieux où les eaux sont basses. S’inscrit dans la même perspective du patrimoine régional l’ensemble important des informations linguistiques et culturelles relevant du domaine de l’onomastique, déjà évoquée, les toponymes et anthroponymes pouvant être considérés pour leur intérêt linguistique, mais aussi pour leur intérêt socioculturel, patrimonial et géographique, ce domaine de la connaissance s’étant, du XVIIe au XVIIIe siècle, considérablement développé en relation avec le goût pour les voyages et la découverte du monde3. Resterait à se demander quels furent les textes qui offraient des témoignages linguistiques critiques, susceptibles de fonder un usage, d’autoriser des usages, quelle place fut faite à l’oral et par qui… Mais nous sommes bien loin de pouvoir épuiser le sujet, car outre le vaste ensemble, très important pour une meilleure connaissance de l’histoire de la langue, des parlers minoritaires, inégalement reconnus, qui offriraient de beaux sujets de recherche aux jeunes générations de chercheurs, on aura compris qu’il reste désormais à évoquer le mythe de la langue commune telle qu’elle a pu être représentée sous l’Ancien Régime dans des dictionnaires : les lexicographes, persuadés que seule la langue écrite pouvait être reconnue, furent surtout d’abord intéressés par la langue littéraire et la langue technique, et la terminologie même de « langue commune » ouvre à la réflexion : outre la question de la place accordée à une langue considérée comme commune dans nos dictionnaires, sur quels critères se fonder pour tenter de définir les principes de délimitation entre langue technique, langue littéraire et langue commune, si ce n’est via une réflexion sur l’identité de ces différentes composantes en relation avec les contextes socioculturels et linguistiques concernés, sur les ambiguïtés du statut des sources dont nous disposons ? Vaste sujet, là encore, qu’il ne nous est pas possible de détailler dans le cadre imparti mais qui invite à rappeler qu’une partie des raisons et motivations d’une norme linguistique réside dans les deux facteurs socioculturels essentiels du développement de l’imprimerie (en relation avec l’accroissement de la population capable de lire) et de la politique linguistique. On mesure enfin l’ampleur des problèmes auxquels sont confrontées l’histoire de la grammaire, l’histoire de la langue, l’histoire même des dictionnaires du fait du nombre restreint des textes traditionnellement pris en compte par les grammaires et ouvrages linguistiques de références, dans des contextes de contraintes, ce qui implique que certains ouvrages, tel le Dictionnaire de Trévoux, aient malheureusement été négligés. Deux facteurs sont alors à considérer : d’une part, la production de dictionnaires au XVIIIe siècle fut confrontée aux attentes d’un public différencié, en constante progression, en quête de norme ou de « publicité » face à la diversité des représentations des usages linguistiques dans l’imprimé, même si le livre imprimé était encore réservé à une élite et à des couches sociales restreintes ; d’autre part, on a compris combien le discours du dictionnaire imprimé, tout en résultant d’initiatives individuelles ou collectives, au service ou non d’institutions ou d’instances politiques (lien entre démarche linguistique et monarchie) et religieuses (le rôle des ordres religieux dans l’instruction et la vie intellectuelle), ne peut jamais être absolument objectif. Ainsi s’opposent les ouvrages d’auteurs (Richelet, Furetière, Ménage) aux ouvrages d’institutions (l’Académie française), les ouvrages portés par le pouvoir, la monarchie de droit divin, tel le Dictionnaire de l’Académie française, aux ouvrages portés par des communautés religieuses et du coup dénigrés par des groupes de pression idéologique opposés, tel le Dictionnaire de Trévoux : né grâce à la volonté de membres de la communauté jésuite, influents à Paris et à Lyon, cet ensemble lexicographique, quoique ouvert à des contributions laïques, a souffert ensuite de sa réputation exagérée de « dictionnaire de jésuites » orchestrée notamment, à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, pour partie par Voltaire et les encyclopédistes… alors qu’on sait désormais à quel point il fut un dictionnaire « missionnaire » au service du rayonnement de la langue française dans l’Europe des Lumières. Mais une autre page de l’histoire du Dictionnaire de Trévoux s’ouvre à nous désormais, celle de sa destinée, de sa réception. 1Sur ce sujet, cf. Isabelle TURCAN, « Les anthroponymes dans la lexicographie française monolingue du XVIIe et XVIIIe siècles », in L’Onomastique au carrefour des sciences humaines. Actes du XIe colloque de la Société française d’Onomastique (Université Lyon 3, 10-13 octobre 2001), éd. B. Horiot et C. Veleanu, Centre d’études linguistiques Jacques Goudet, Université Jean Moulin Lyon 3, 2005, pp. 325-348 ; « L’onomastique dans l’histoire du Dictionnaire universel […] de Trévoux (1704-1771) : identité culturelle et conscience patrimoniale. », participation au Colloque bisannuel de la S. F. O. (Société Française d’Onomastique), du Le Teich, 9 au 11 octobre 2003, parution dans les actes du colloque Onomastique et patrimoine, textes recueillis et édités par G. Taverdet, ABELL (Association bourguignonne d’études linguistiques et littéraires), Ahuy, novembre 2004, pp. 327-350. 2Cf. Isabelle TURCAN (études sur les éditions lorraines du Dictionnaire de Trévoux, à paraître). 3Cf. le texte de la conférence proposée par le Professeur Jacques CHAURAND. © Isabelle Turcan (janvier 2012) |